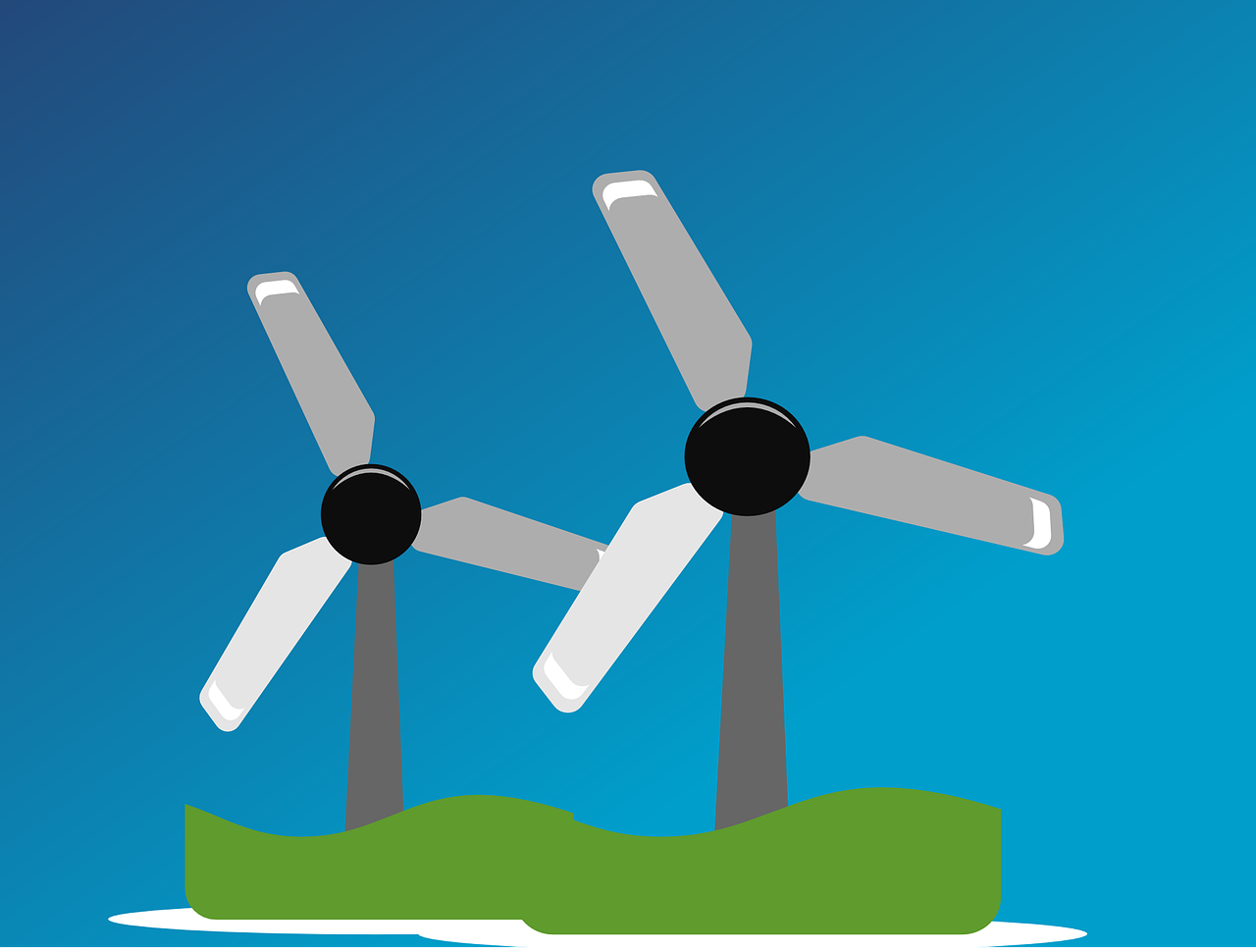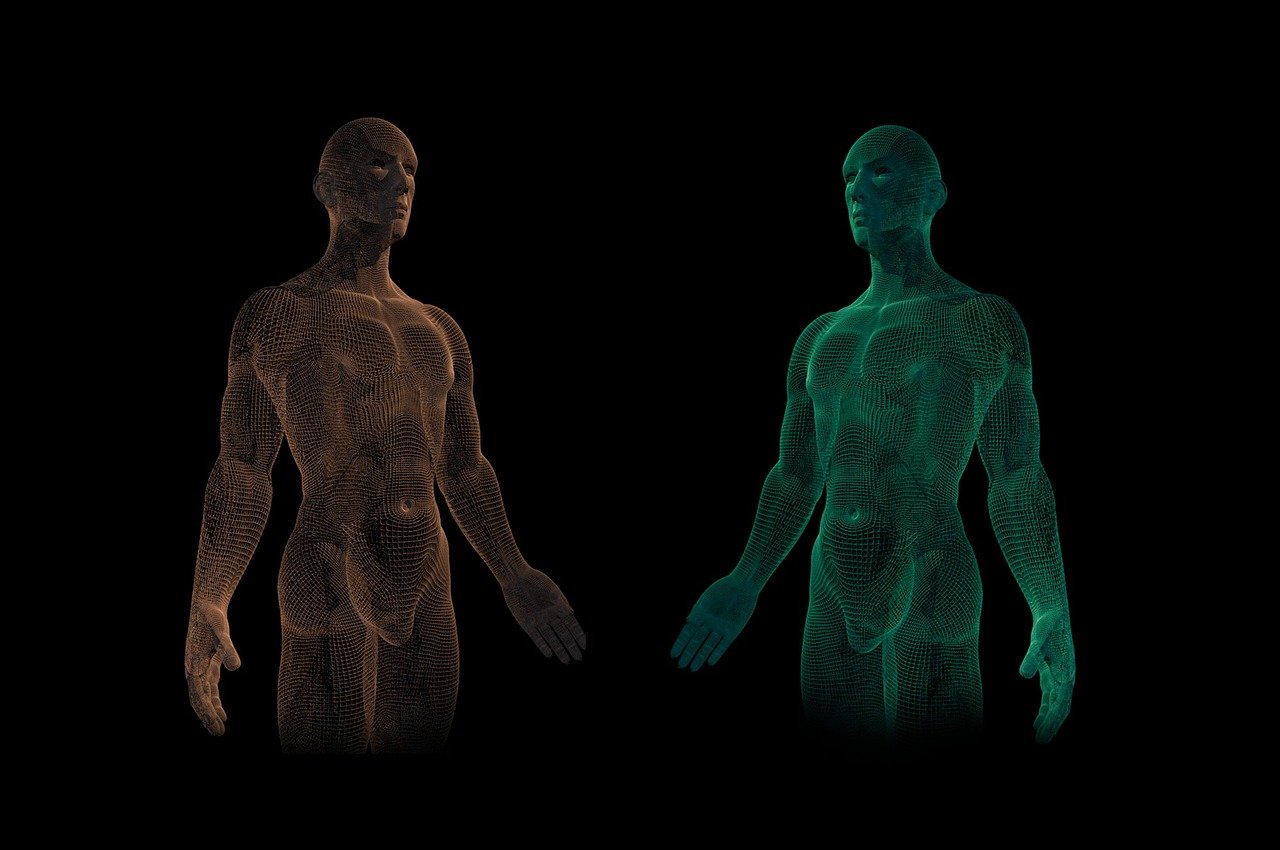|
EN BREF
|
L’usage croissant des services numériques a un impact significatif sur la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. Les data centers des géants du cloud, comme Amazon, Microsoft et Google, consomment entre 6 % et 10 % de l’électricité mondiale, ce qui soulève des questions sur leur responsabilité écologique. Chacune de ces entreprises a annoncé des objectifs ambitieux de neutralité carbone, mais ces déclarations sont souvent critiquées pour leur manque de fondement scientifique. Par exemple, si Google se déclare neutre en carbone, Amazon vise la neutralité d’ici 2040, et Microsoft se fixe comme objectif d’être « carbone négative ». Cependant, les méthodes qu’ils utilisent, comme l’achat de crédits carbone et le financement de projets environnementaux, peuvent créer une illusion de durabilité sans réduire en valeur absolue leurs propres émissions. De plus, leur stratégie se concentre principalement sur l’approvisionnement en énergies renouvelables, sans véritable engagement à réduire la consommation d’énergie et les matières premières utilisées dans leur chaîne de production.
Avec la montée en puissance des services numériques, l’impact environnemental du cloud computing est devenu une préoccupation majeure. Les géants technologiques comme Amazon, Microsoft et Google, souvent désignés sous le terme de hyperscalers, jouent un rôle central dans cette question. Alors que leur infrastructure numérique continue de s’étendre, il est crucial d’évaluer dans quelle mesure ces entreprises prennent conscience et assument la responsabilité de leur empreinte carbone. Cet article explore l’évolution de la consommation énergétique liée au cloud, examine les engagements climatiques des principales entreprises, et discute de l’efficacité de leurs stratégies actuelles pour atténuer leur impact environnemental.
L’évolution de la consommation énergétique du cloud
Depuis quelques années, l’utilisation des services cloud a explosé. Cette évolution est directement liée à l’augmentation vertigineuse des données générées à l’échelle mondiale. Entre 2013 et 2017, la consommation énergétique du secteur a augmenté de 50 %, représentant maintenant entre 6 % et 10 % de la consommation mondiale d’électricité. Les data centers, essentiels pour le traitement et le stockage des données, nécessitent une quantité colossale d’énergie pour fonctionner. Non seulement leur fonctionnement quotidien requiert une énergie importante, mais leur fabrication engendre également une mobilisation massive de matières premières, avec des impacts environnementaux étendus.
Les hyperscalers comme Amazon, Microsoft et Google, se sont engagés dans cette voie, mais le questionnement demeure : prennent-ils véritablement en compte ces enjeux environnementaux dans leurs stratégies d’entreprise ?
Les engagements climatiques des géants du cloud
Les trois principales plateformes de cloud, AWS, Azure et Google Cloud, affichent des ambitions « net zéro » pour réduire leur empreinte carbone. Chaque entreprise propose des objectifs selon des timelines variées. Par exemple, Google se considère neutre en carbone depuis 2007 grâce à l’achat de crédits carbone pour compenser ses émissions. Mais peut-on réellement croire à la neutralité en carbone lorsqu’une grande partie de leurs activités peut indirectement contribuer à augmenter les émissions.
De son côté, Amazon a annoncé un objectif « Net-Zero Carbon » d’ici 2040, tandis que Microsoft ambitionne d’être « carbone négatif » à une date encore à préciser. Toutefois, derrière ces annonces, se cache une réalité préoccupante : les efforts pour réduire les émissions sont souvent superficiels, se concentrant principalement sur l’achat de crédits carbone au lieu d’intervenir en profondeur sur leur consommation directe.
Les limites des objectifs « net zéro »
Le langage autour de la neutralité carbone et des objectifs « net zéro » peut prêter à confusion. Ces termes suggèrent que les entreprises pourraient annuler leur empreinte carbone par des crédits d’émission, tant et si bien que l’impact de leur activité sur le climat pourrait sembler atténué, alors qu’en réalité, il est toujours bien présent. Scientifiquement, la neutralité carbone ne peut être atteinte qu’à l’échelle mondiale, et non à celle des entreprises individuelles.
Les entreprises doivent comprendre que, même si elles se proclament neutres en carbone, cela peut être trompeur sans une réelle réduction des émissions mises en œuvre dans leurs processus opérationnels. En effet, un engagement à augmenter les puits de carbone, par exemple, ne se substitue pas à des efforts concrètes pour réduire les émissions à la source.
Consommation d’énergie et énergies renouvelables
La consommation énergétique des services cloud ne se limite pas seulement à l’opérationnalisation des serveurs. Les data centers dépendent de l’électricité pour à la fois alimenter les équipements et les refroidir. Par conséquent, chaque hyperscaler cherche à s’approvisionner en énergies renouvelables pour compenser leurs besoins en électricité.
Il existe plusieurs méthodes pour revendiquer l’utilisation d’électricité renouvelable : l’achat de Garanties d’Origine, le financement de nouvelles capacités d’énergie renouvelable via des contrats à long terme, ou la création de parcs de production d’énergie renouvelable. Cependant, ces mécanismes peuvent souvent masquer la réalité selon laquelle, en pratique, ces entreprises restent reliées au même réseau électrique, dont la mixité énergétique peut être encore majoritairement fossile.
La réalité des énergies renouvelables dans les data centers
Il n’est pas rare que les trois géants cités, en particulier Amazon et Google, achètent d’importantes quantités d’électricité labellisée renouvelable. Néanmoins, il faut se demander si ces achats conduisent à un réel changement dans le mix énergétique des sites où se situent leurs data centers. D’ailleurs, la mise en conformité avec un système de compensation peut ne pas se traduire par une réelle efficacité énergétique.
En conséquence, une forte consommation d’électricité, même renouvelable, ne signifie pas qu’il n’existe pas d’autres impacts environnementaux liés à l’appareil numérique. Par exemple, il serait réducteur de ne considérer que la consommation actuelle d’électricité, sans prendre en compte les gaz à effet de serre générés lors de la fabrication, de l’installation, ou de l’élimination des équipements de data centers.
Performance carbone : le cloud est-il véritablement la solution ?
Les entreprises de cloud computing avancent souvent que, grâce à l’optimisation des ressources et à la mutualisation des serveurs, l’usage du cloud serait plus performant sur le plan carbone comparé aux solutions traditionnelles « on premise ». Cependant, ces affirmations méritent d’être examinées de près.
Les arguments en faveur du cloud
Les principaux arguments avancés pour défendre cette idée de réduction des émissions incluent l’utilisation plus efficace des infrastructures par le biais d’une meilleure gestion des serveurs. En effet, les hyperscalers affirment que leurs machines sont souvent utilisées à capacité maximale, contrairement à des solutions « on premise » où de nombreux serveurs sont sous-utilisés. De plus, pour améliorer leur processus, des avancées en termes de Power Usage Effectiveness (PUE) ont été réalisées, permettant de réduire la consommation d’énergie dans les data centers.
Les conséquences de l’effet rebond
Dans la réalité, ces arguments peuvent être battus en brèche. L’effet rebond, par exemple, indique qu’en payant pour des services à l’usage, les clients peuvent avoir tendance à surconsommer, pensant que la capacité est infinie. Par ailleurs, la redondance des données et des infrastructures à des fins de fiabilité dans le cloud pourrait conduire à une surconsommation inutile d’énergie. Ainsi, la promesse d’une empreinte carbone nettement inférieure à celle des systèmes traditionnels se heurte à la réalité des comportements d’utilisation.
Les implications de l’impact environnemental des hyperscalers
Il est indiscutable que la vulnérabilité climatique est un enjeu crucial pour les hyperscalers. Leurs actions et décisions en matière d’environnement façonnent le secteur numérique dans son ensemble. En manque de transparence sur leurs émissions réelles, leurs initiatives semblent parfois plus symboliques que concrètes.
Par ailleurs, des plateformes comme Google Cloud et Azure font des efforts pour offrir à leurs clients des outils de mesure de leur empreinte carbone. Ces initiatives sont un bon début, mais incluent souvent des limites en matière de précision et d’intégralité. Les clients doivent prendre conscience que les outils de mesure des émissions dépendent du périmètre couvert et de la méthodologie de calcul.
Un avenir durable pour le cloud ?
Pour répondre aux défis climatiques, les hyperscalers doivent envisager des modèles d’affaires qui minimisent la surconsommation des ressources et agissent sur l’efficacité énergétique. Leurs engagements pour de futures réductions d’émissions devraient inclure des plans d’action concrets pour réduire les consommations d’énergie et de ressources.
Le défi est de taille. Comme le secteur numérique continue d’évoluer, l’accroissement des services cloud devra être attentivement scruté, et les géants de la technologie seront tenus de démontrer leur engagement envers l’environnement au-delà de simples assurances de communication. L’exigence croissante des consommateurs pour une transparence envers les engagements écologiques pourrait changer la manière dont ces entreprises intègrent la durabilité dans leurs opérations.
Pour aller plus loin sur ces problématiques de l’expansion du cloud et de ses impacts, vous pouvez consulter ce lien sur l’empreinte carbone du cloud, ou explorer d’autres articles traitant de l’impact environnemental de la production d’électricité.
Le temps est venu pour les hyperscalers de montrer qu’ils peuvent concilier croissance numérique et responsabilité environnementale. L’évaluation de leur empreinte carbone devrait être au cœur de leurs stratégies futures.

La prise de conscience croissante des enjeux environnementaux suscite des questions sur la réelle responsabilité des géants du cloud. Amazon, Microsoft et Google, en tant qu’acteurs majeurs dans ce domaine, affichent des ambitions ambitieuses de réduction de leur empreinte carbone. Cependant, les pratiques et les stratégies mises en œuvre soulèvent des interrogations quant à leur engagement véritable envers la neutralité carbone.
Un utilisateur de services cloud d’Amazon déclare : « Il est difficile de savoir dans quelle mesure leurs annonces sur la durabilité sont réellement suivies d’actions concrètes. Ils parlent de leur objectif d’atteindre le ‘Net-Zero’ d’ici 2040, mais cela semble plus une question de marketing qu’une véritable stratégie opérationnelle. »
De son côté, un responsable informatique qui travaille avec Google Cloud confie : « Bien que Google ait établi un plan pour fonctionner sur de l’électricité sans carbone d’ici 2030, les défis liés à la fabrication et à la mise en réseau demeurent sous-évalués. La durabilité ne se limite pas à l’approvisionnement en énergie, mais implique également la réduction des autres impacts environnementaux. »
Un analyste des marchés technologiques souligne : « Microsoft annonce des progrès impressionnants en matière d’énergies renouvelables. Toutefois, il est nécessaire d’examiner comment ils mesurent et communiquent réellement leurs émissions de gaz à effet de serre. Leur méthodologie peut manquer de rigueur, ce qui peut masquer l’ampleur de leur impact réel. »
Un expert en durabilité ajoute : « La mutualisation des ressources dans les centres de données est souvent citée comme un avantage environnemental des services cloud. Cependant, cette perspective ne prend pas en compte le fait que l’effet rebond peut conduire à une augmentation de la consommation en raison de la perception de capacités illimitées. »
Enfin, un étudiant en environnement exprime : « Les engagements des hyperscalers à compenser leurs émissions avec des crédits carbone sont préoccupants. Cela pourrait créer une illusion de responsabilité écologique tout en permettant de poursuivre des pratiques polluantes. Une approche plus transparente et engagée serait nécessaire pour véritablement contribuer à la lutte contre le changement climatique. »